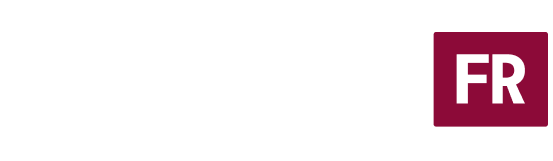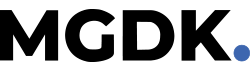Les conséquences économiques de la guerre de la Russie en Ukraine ne se mesurent pas seulement en armes et en sanctions
En ce moment, d'autres lisent
Les conséquences économiques de la guerre de la Russie en Ukraine ne se mesurent pas seulement en armes et en sanctions — elles s’inscrivent aussi dans les bilans financiers de centaines d’entreprises étrangères.
Depuis 2022, les entreprises internationales ont accumulé environ 170 milliards de dollars de pertes en tentant de quitter le marché russe ou de continuer à y opérer sous de nouvelles restrictions.
Et pourtant, alors que certains signes de détente diplomatique apparaissent, certaines entreprises envisagent un retour — une décision que les analystes estiment encore plus risquée sur les plans financier et juridique.
Après les atrocités de Boutcha, Irpin et d’autres banlieues de Kyiv au début de 2022, une vague de multinationales a quitté le marché russe.
Lire aussi
Mais pour celles qui pensaient partir à leurs propres conditions, Moscou en avait décidé autrement.
Au cours des trois dernières années, la Russie a eu recours à des saisies d’actifs, des taxes punitives et des remises forcées pour extorquer des milliards aux entreprises occidentales partantes. Beaucoup n’ont jamais récupéré ne serait-ce qu’une fraction de leurs investissements initiaux.
Une stratégie de sortie à prix fort
Les pertes sont colossales.
Selon un rapport de la Kyiv School of Economics, les entreprises étrangères ont perdu 167 milliards de dollars en dépréciations d’actifs et 3 milliards supplémentaires en « taxes de sortie ».
Parmi les pays les plus touchés :
- États-Unis : 46 milliards de dollars
- Allemagne : 44,5 milliards de dollars
- Royaume-Uni : 35,1 milliards de dollars
- France, Autriche, Finlande : 24 milliards de dollars combinés
La majorité de ces pertes provient de grands groupes énergétiques et industriels.
British Petroleum a perdu environ 25,5 milliards de dollars, Uniper 22 milliards, et ExxonMobil 4 milliards.
Renault, Fortum et Société Générale figurent également parmi les grandes entreprises touchées, souvent contraintes de vendre leurs actifs à une fraction de leur valeur — ou, dans certains cas, empêchées de vendre quoi que ce soit.
Le mode opératoire russe de la « gestion temporaire »
Ce qui avait commencé comme des désinvestissements volontaires s’est vite transformé en appropriation forcée d’actifs pilotée par l’État.
En 2023, le Kremlin a commencé à transférer les actifs d’entreprises américaines et européennes à Rosimushchestvo, un organisme public chargé de la « gestion temporaire ».
Bien que la Russie ait affirmé que la propriété n’avait pas changé, en pratique, les entreprises étrangères ont totalement perdu le contrôle.
Carlsberg et Danone en sont deux exemples emblématiques.
Les deux avaient identifié des repreneurs locaux pour leurs activités russes. Les deux ventes ont finalement été bloquées.
L’entreprise de Carlsberg, autrefois valorisée à plus d’un milliard d’euros, a été vendue pour un peu plus de 300 millions. Les actifs de Danone ont perdu plus de la moitié de leur valeur avant qu’une vente ne soit enfin autorisée.
Ces ventes — souvent dirigées vers des entreprises liées au Kremlin — servaient des objectifs à la fois politiques et économiques.
Elles ont injecté du capital dans l’économie de guerre russe tout en renforçant l’image de stabilité intérieure malgré les sanctions internationales.
Le risque d’un retour
Malgré ces leçons coûteuses, les efforts récents de cessez-le-feu ont fait naître des spéculations sur un possible retour des entreprises occidentales en Russie.
Mais les experts avertissent que l’environnement est encore plus instable qu’avant.
Les lois qui ont permis les saisies d’actifs sont toujours en vigueur. Les transferts de capitaux à l’étranger nécessitent toujours des autorisations spéciales. Des taxes rétroactives sur les bénéfices peuvent toujours être imposées. Et le climat géopolitique demeure hautement imprévisible.
Même si la guerre ralentit, le nationalisme économique qu’elle a déclenché ne disparaîtra probablement pas.
D’après la Kyiv School of Economics, au moins 30 grandes entreprises ont vu leurs activités russes effectivement confisquées. Beaucoup servent désormais les intérêts stratégiques de l’État russe, notamment dans le secteur énergétique.
À ce jour, 481 entreprises ont quitté complètement la Russie depuis le début de la guerre.
1 357 autres ont réduit ou suspendu leurs activités, beaucoup d’entre elles évoluant encore dans un environnement juridique et financier incertain.